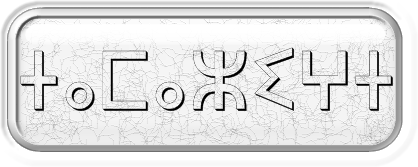Nous dédions cet article à tous les Berbères qui ont adoptés les us et coutumes bédouino-mohamétanes très rapidement. C’est également valable pour les Européens.
L’histoire et la géographie établissent que l’Algérie est une invention récente, et elles montrent qu’aucune des conditions nécessaires à la formation d’une littérature propre (unité de peuplement, unité de langage, unité nationale) n’a jamais été remplie dans ce pays.
Pourtant, il y a toujours eu et il y a des hommes issus de ce terroir, nourris, formés par lui, qui ont fait, qui font acte d’écrivains, qu’ils s’expriment ou se soient exprimés tour à tour en punique, en grec, en latin, en arabe, en français. Il en est même qui, sans écrire, créent une littérature de transmission orale dans les divers dialectes berbères, de la Kabylie au Hoggar.
C’est à ces écrivains, que nous appellerons toujours « Algériens » pour la commodité de l’exposé, à eux seulement que sera consacré notre examen, sans retenir, sinon dans quelques cas particulièrement significatifs, les écrivains « étrangers » qui ont écrit sur l’Algérie, nous attachant en définitive à chercher ce qu’a été jusqu’à ce jour une littérature faite par l’Algérie, pour découvrir au moins les traits d’un domaine algérien de la littérature en général. Tout tableau littéraire de l’Algérie devrait avoir pour arrière-plan son âge punique et carthaginois. Nous pouvons bien songer avec regret à une littérature carthaginoise, mais nous ne la ressusciterons pas, si tant est qu’elle ait existé. En détruisant Carthage, les Romains ne nous ont pas laissé les moyens de vérifier si nous avons beaucoup à regretter. Mais cela se saurait. Au demeurant, Carthage fut une vulgarisatrice plutôt qu’une créatrice de culture. Elle a diffusé l’influence hellénique ; grâce à elle c’est le grec qui fut la langue des intellectuels nord-africains. Le grand Massinissa, le plus berbère des dynastes, fit donner à ses fils une éducation grecque. L’un d’eux, Micipsa, vivait entouré de lettrés grecs. C’est en grec qu’écrivait le roi numide Hiempsal dont Salluste a consulté les récits ; c’est en grec que Juba II, le roi berbère de notre Cherchell algérienne, rédigea ses nombreuses compilations, poussant même jusqu’à étudier les causes de corruption de la langue d’Homère. Et Plutarque n’a pas dédaigné de lui emprunter quelques traits.
De même que le punique et le grec s’étaient superposés aux idiomes berbères, le latin s’implanta en Afrique au temps d’Auguste. Le christianisme ne devait pas tarder à l’y répandre largement. Des Berbères romanisés ou des Romains berbérisés vont donc apporter à la littérature latine une contribution nouvelle, importante en qualité et en quantité.
Peut-on considérer ces écrivains comme ayant constitué un domaine proprement africain de la littérature latine ? On l’a tenté. Ce fut la thèse de Paul Monceaux, qui voyait dans le latin écrit par les écrivains d’Afrique des tournures si particulières qu’il en résulterait presque une langue propre à ces Africains. Mais cette thèse n’est plus guère admise. Il est bien malaisé, au dire des spécialistes, de définir les africanismes de vocabulaire et de syntaxe. Nous ne pouvons isoler que par artifice ces écrivains de l’ensemble auquel ils participaient. Si l’on peut parler d’un siècle de Saint-Augustin l’Africain, n’oublions pas que ce fut aussi le siècle de Saint-Jérôme le Dalmate. Ainsi, la littérature française a-t-elle en même temps Corneille, normand, et Pascal, auvergnat.
Il est encore plus difficile d’isoler les « Algériens » de l’ensemble des écrivains latins d’Afrique. Car l’Afrique romaine a englobé tout le pays, des Syrtes à l’Atlantique, modifiant, selon les époques, la longueur, la profondeur, l’étendue, le nom de ses diverses provinces. Il n’y a pas de différence de nature entre l’écrivain latin Tertullien, qui appartint à l’espace de l’actuelle Tunisie, et l’écrivain latin Saint-Augustin, qui appartint à l’espace de l’actuelle Algérie. En outre, assez nombreux sont les écrivains dont nous savons seulement qu’ils étaient « africains » sans plus de précision. Pour nous en tenir à notre propos, nous ne nous étendrons ici que sur les « Algériens » confirmés.
Le siècle d’Auguste n’a guère produit que Fiorus et Manilius, dont il y a peu à dire. C’est à partir du IIe siècle qu’on voit les écrivains africains s’imposer dans la littérature latine avec deux grands noms : Fronton et Apulée.
Fronton est né à Cirta, notre Constantine. Mais à vrai dire, il a vécu dans tout l’empire, menant une vie comblée d’honneurs, pour avoir été le maître à penser de deux empereurs, dont Marc-Aurèle. Ce n’est pas un mince titre de gloire, et qui vaut à nos yeux autant que ses Discours, ses Éloges et ses autres traités, où ses contemporains virent d’ailleurs « la parure de l’éloquence romaine ».
Apulée, qui vivait à la même époque, est passé bien plus brillamment à la postérité. On lit encore, on réimprime souvent son œuvre la plus fameuse. Il était né à Madaure, actuellement M’daourouch, du côté de Tébessa, qui était une cité florissante. Il y fit ses premières études, puis à Carthage, où il enseigna ensuite la rhétorique avant de parcourir le monde, en quête d’aventures autant spirituelles que physiques. L’une de ces aventures lui valut un procès en sorcellerie dont le principal avantage, pour nous, est que notre homme se défendit lui-même en composant son apologie qui reste un petit chef-d’œuvre d’astuce et d’humour.
Ce seraient aussi ses propres aventures qu’il nous aurait racontées dans ses Métamorphoses, plus connues sous le nom fameux de l’Âne d’or, un des très rares romans de l’antiquité, roman fantastique et de magie, où l’on peut voir une anticipation de cette métapsychie que notre époque a mise à la mode. Mais ce roman nous touche bien plus encore par le charmant épisode d’Éros et de Psyché qui y est inséré.
L’Âne d’or, l’Apologie, les Florides, recueil d’anecdotes, une Doctrine de Platon, un traité sur le Génie de Socrate, etc. l’œuvre d’Apulée suffit à illustrer une littérature et un pays. On comprend que ses compatriotes, de son vivant, lui aient élevé des statues, et que ses « descendants » aujourd’hui se réclament encore de son exemple.
Bien qu’il soit « tunisien » puisqu’il naquit, vécut et mourut à Carthage, il faut au moins marquer ici la place historique et chronologique du grand Tertullien, ne fût-ce que pour opposer au païen Apulée ce fougueux docteur de l’Église dont Chateaubriand a dit que « ses motifs d’éloquence sont pria dans le cercle des vérités éternelles ». Et aussi parce qu’il y a en lui un archétype d’Africain violent, passionné, en perpétuel état de révolte jusqu’à devenir une espèce d’antitout. En tout cas, il est le premier grand animateur de la littérature chrétienne d’Afrique, qui va compter tant de Pères de l’Église, d’apologétistes, de polémistes, de théologiens, d’hérésiarques, de saints et de martyrs.
À la même époque que Tertullien, au début du IIe siècle, nous trouvons déjà un document de premier ordre, qui lui a d’ailleurs été attribué : La Passion de Sainte-Perpétue, dont Paul Monceaux a pu dire que c’était « une œuvre charmante, pleine de grâce et de vérité, un des bijoux de la vieille littérature chrétienne ». Nous trouvons encore un Minucius Félix, originaire de notre Tébessa algérienne, qui a laissé au moins le célèbre dialogue de l’Octavius, dont un des personnages est d’ailleurs un Constantinois et que Renan tenait pour « la perle de la littérature apologétique ».
Faute de pouvoir les annexer à l’Algérie, nous ne nous arrêterons pas à saint Cyprien, Commodien. Arnobe, Lactance (ce prophète de l’âge d’or), qui ont tant de titres à notre considération, non plus qu’à ces poètes mineurs, grammairiens, versificateurs, qui mettent Virgile en centons, tels que Sammonicus, Nemesien, Reposianus.
Voici le IVe siècle, il nous faut arriver sans tarder à ceux qui participèrent à la grande querelle, à la fois schisme et guerre sociale, du donatisme : c’est-à-dire au plus grand de tous les Algériens, de tous les Africains, saint Augustin.
Pour l’histoire et l’intelligence des idées, il faudrait considérer dans le détail les innombrables poléiques qu’engendra le donatisme, car elles constituent la toile de fond du panorama augustinien. Finalement, Augustin fit triompher l’orthodoxie catholique, mais ses adversaires ne furent pas négligeables. Donat, le fondateur de la secte ; Parmenianus, son successeur ; Petilianus, Gaudentius (de Timgad) se sont révélés, non seulement des orateurs, mais des pamphlétaires de talent. Il est vrai que l’orthodoxie avait déjà trouvé, elle aussi, un défenseur de la classe de saint Optat, évêque de Milève (près de Constantine), cependant qu’un Tyconius illustrait le tiers parti.
Mais tout cela, précurseurs, partisans, adversaires, tout cela disparaît vite à nos yeux derrière la grande figure de saint Augustin.
La vie d’Augustin nous est bien connue, puisqu’il l’a lui-même racontée dans cet immortel chef-d’œuvre : les Confessions. Il naquit en 354 à, Thagaste (notre Souk-Ahras), de parents berbères romanisés : Monique, née chrétienne, et Patricius, resté païen. L’influence que la mère a exercée sur le fils est bien connue : sainte Monique a deux fois mis au monde Augustin, l’homme et le saint.
Écolier à Madaure, étudiant à Carthage, il a mené d’abord une vie très « mondaine », adonné aux plaisirs et aux passions. Puis il fut professeur, vendant son savoir dans diverses écoles, à Carthage, à Rome, à Milan. C’est là qu’il connut la fameuse « journée d’illumination » qui le conduisit au baptême. Il avait trente-trois ans.
Devenu prêtre, puis évêque d’Hippone (notre Bône), il le restera jusqu’à sa mort, survenue le 28 août 430 dans sa ville assiégée par les Vandales de Genséric.
Saint-Augustin a passé sa vie catholique à combattre le paganisme et les hérésies qui foisonnaient, celles de Planés et de Pélage, l’arianisme et le donatisme. Cette lutte lui a fait produire une masse d’écrits polémiques, d’abondants traités, une nombreuse correspondance. Dans toute cette littérature de circonstance se révèle le grand écrivain que les Confessions affirment, mais aussi le robuste penseur et l’homme d’action.
Ce n’est pas qu’Augustin ait été tout d’une pièce, comme on dit. Bien au contraire. Avant même sa conversion au catholicisme, il avait traversé une crise spirituelle dans laquelle il avait été longuement séduit par le manichéisme. C’est par là qu’on peut voir qu’il incarne de la façon la plus évidente une des constantes du génie nord-africain : le dualisme. Tiré de part et d’autre vers ses extrêmes, il a lutté, sa vie durant, pour résoudre ses contradictions, allant de ce qu’on pourrait appeler un romantisme du sentiment à un classicisme de la forme et de la pensée, cherchant à se donner lui-même les disciplines d’une mesure humaniste qui pût contraindre sa démesure native. Et il y est parvenu, au terme de sa longue existence, en édifiant cette solide synthèse intellectuelle, cette haute construction de l’esprit qu’est la Cité de Dieu, sur les ruines de son univers : les Goths étaient entrés dans Rome et les Vandales assiégeaient sa propre cité. Mais en mourant saint Augustin laissait au génie de l’Afrique la pensée la plus durable dans l’œuvre la plus classique, qui ne devait pas cesser, pendant des siècles et jusqu’à nos jours mêmes, d’alimenter la vie spirituelle de l’Occident, la philosophie chrétienne et jusqu’à la littérature émouvante des âmes avides de se confesser.
S’il existe un exemple valable, depuis Ulysse, du dualisme : méditerranéen surmonté par soi-même dans l’unité de l’Esprit, c’est bien celui de saint Augustin. Et que cet exemple nous vienne d’un « Algérien », de ce pays toujours déchiré entre ses tendances extrêmes, entre l’Occident et l’Orient, entre la passion et la raison, il me semble que c’est là un phénomène plein de conséquences et propre à nous faire méditer sur les possibilités de l’avenir nord-africain.
Toute grande époque a sa décadence et ne finit pas d’un seul coup. La littérature latine n’est pas morte avec saint Augustin et les Africains ont continué pendant près de deux siècles à lui fournir une contribution qui n’a pas toujours été sans intérêt. Du vivant même d’Augustin on vit paraître au moins deux Algériens notables : le poète Licentius, qui était de Thagaste, comme Augustin, - et qui avait d’ailleurs été son élève, et surtout Martianus Capella, qui était de Madaure comme Apulée, et qui comme celui-ci nous a laissé un roman, les Noces de Mercure et de la Philologie, dont on pourrait dire qu’il forme une espèce d’encyclopédie allégorique.
Mais déjà l’Afrique romaine était devenue vandale, au moins par son gouvernement. À la cour des rois barbares, on menait en fait une vie fort raffinée. Les écrivains s’y pressaient pour célébrer, toujours en latin, la joie de vivre. Hommes de la décadence, courtisans, poètes mineurs, il leur arrive pourtant de ne pas manquer d’ambitions créatrices et de trouver des traies mémorables. Tel ce Dracontius, dont un vaste poème didactique peut faire penser à Milton ; tel ce Fulgence qui fait penser à Dante, car lui aussi, mais huit siècles plus tôt, il était descendu aux enfers avec Virgile pour guide. Le grand historien Stéphane Gsell a pu dire que le dialogue de Virgile et de l’Africain Fulgence était, à l’entrée du Moyen-âge, une sorte de lever de rideau burlesque de la Divine Comédie.
Après les Vandales, les Byzantins, la reconquête de l’Afrique par les Romains d’Orient, l’anarchie, la guerre, les insurrections : époque peu favorable à la vie littéraire. Il en émerge pourtant un fameux grammairien. Priscien, originaire de notre Cherchell, qui a laissé aussi une géographie versifiée, et ce poète-lauréat, Corippus, qui a consacré des épopées à la louange de ses maîtres, et nommément la Johannide au général grec Jean Troglyta.
Mais le VIIe siècle commence, et voici les Arabes. Pour un assez long temps, l’Afrique du Nord, devenue le Maghreb, est entrée dans ce que l’historien E.F. Gautier appela ses « siècles obscur ».
Gabriel AUDISIO